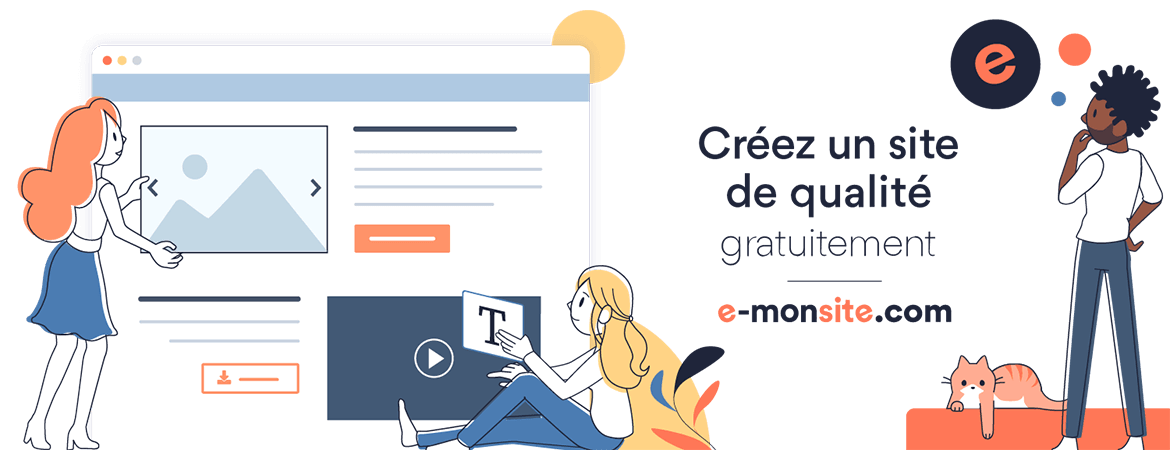Ppe (108.63 Ko)
Joe 20161119 0269 0043 (155.39 Ko)
Projet pour l'enfant : parution du décret sur le rapport de situation vérifiant sa mise en oeuvre
• Par Sandrine Vincent - 21/11/2016
Un décret, publié samedi 19 novembre au Journal officiel, définit le référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant - rapport qui, rappelle la notice du texte, doit permettre de "vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant" (PPE) par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice.
Pour mémoire, afin d'améliorer la qualité du suivi des enfants confiés à l'ASE, la loi du 5 mars 2007 a prévu que cette dernière doit établir un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. La loi du 14 mars 2016 a renforcé cette disposition et renvoyé à un décret le soin de préciser, dans un référentiel, le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. C'est désormais chose faite.
Selon la loi, le rapport de situation, établi après une évaluation pluridisciplinaire, doit porter sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie.
Comme le prévoit déjà la loi, le référentiel énonce que le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Il a pour objectif, précise-t-il, d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être. Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.
Toujours selon le référentiel, le rapport de situation de l'enfant doit prendre en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant, et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants, qui sont aussi ceux retenus dans le PPE :
• le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
• les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ; • la scolarité et la vie sociale de l'enfant.
Le rapport de situation doit également porter, le cas échéant, sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant.
Le rapport de situation de l'enfant doit présenter :
-
les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;
-
le bilan de la mise en oeuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en
exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;
-
le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
• pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie.
Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :
-
des ajustements du plan d'actions prévu dans le PPE ;
-
des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
-
des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;
-
un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance. Il donne,
le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique
de l'enfant ;
-
la saisine de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la
situation des enfants placés à l'ASE depuis plus de 1 an en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Le rapport de situation doit contenir les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période, indique encore le décret.
Le président du conseil départemental doit porter le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement. Pour rappel, en effet, la loi prévoit qu'il doit être transmis au juge qui a confié l'enfant aux services de l'ASE une fois par an ou tous les six mois pour les enfants de moins de 2 ans.
Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles (J.O. du 19 novembre 2016).
 Since the admin of this website is working, no hesitation very
Since the admin of this website is working, no hesitation very I comment whenever I especially enjoy a article on a site or I have something to valuable
I comment whenever I especially enjoy a article on a site or I have something to valuable